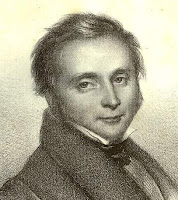|
| en 1997 |
Sur les brocantes et marchés aux puces régionaux, je trouvais régulièrement des partitions éditées à Malo-les-Bains par un mystérieux Jacky Delson, que je n'arrivais pas à identifier. Les adresses ne correspondaient à rien dans les annuaires. Enfin un jour, sur un moteur de recherche je trouve ce commentaire sur un site (d'un ancien élève du collège d'Autun) maintenant disparu : Pierre Sonneville•, dit "BLAIR". On ne présente plus ce chef de musique émérite. Hélas pour lui, chargé des cours de solfège, il n'a jamais pu dépasser la première page du manuel. Grand adepte du magnétophone grâce auquel il s'évertuait vainement à faire aimer la musique classique. On raconte qu'il aurait composé la mélodie du succès international "un oranger sur le sol irlandais" (attribuée à Emile Stern). Selon d'autres sources, il composait des "twist" et des "madison" en se cachant sous le pseudonyme de "Jacky Delson" pour ne pas éveiller les soupçons de sa hiérarchie. Je contacte l'auteur [Bernard Mir] qui transmet mon message à Pierre Sonneville. Quelques mois plus tard, en 2006, j'ai pu échanger quelques mails avec ce compositeur :
Mon père• était musicien amateur, violon et mandoline, ma mère a toujours rêvé de faire de la musique mais n'a pu réaliser son rêve donc tous deux ont reporté leur passion sur ma sœur et moi-même. J'ai commencé par l'accordéon avec Abel LAMOTE comme professeur, j'étais très copain avec son frère Raymond LAMOTE, nous avions le même âge. Puis ma sœur• et moi avons eu des cours par Mr Vandecastel [Vandecasteele]
. Ensuite j'ai étudié le saxophone au Conservatoire de Lille où j'ai obtenu un premier prix de solfège et deuxième prix de saxophone. La suite, service militaire en Allemagne où j'ai eu la chance d'avoir un sous-chef formidable qui m'a enseigné l'harmonie et encouragé à faire carrière, grâce a lui, concours de sous-chef réussi en 1950, me voilà donc affecté à Tunis au 4e régiment de Zouaves avec un patron d'une extrême gentillesse, c'est avec lui que j'ai "pondu" quelques "saucissons" comme on dit, son nom, Raymond RICHARD dit RICHARD de L'ILE•.
En 1957, affecté à l'EMP à Autun où je suis resté 11 ans. J’étais à Tunis lors des évènements pour l’indépendance, rien à voir avec le drame de l’Algérie, les tunisiens manifestaient dans la rue et scandaient « Ha-bib Bourguiba » sur l’air des lampions, c’est à dire deux longues syllabes « Ha - - - Bib - - - et trois courtes Bourguiba . . . ce rythme m’a inspiré et j’ai « pondu » un quatuor pour saxophone [
Andante et scherzo]
en mettant en application ce que j’avais appris en harmonie et contrepoint, je dois vous dire que c’est la seule composition que je trouve intéressante, malheureusement égarée au cours de mes nombreux déménagements, avec ce quatuor j’ai obtenu le premier prix des Rosati de Flandres vers 1956/57. Après Autun j’ai été affecté à Djibouti, reçu au concours de chef de musique, affecté à Amiens, puis à Rennes et enfin en Allemagne à Rastatt, près de Baden Baden où j’ai terminé ma carrière en 1980.
Avec ce message il joint une photo et une coupure de presse parue en 1938 : "
Jeunes prodiges à Saint Pol sur Mer - Deux accordéonistes de 6 ans et demi et 11 ans. — Dimanche dernier a eu lieu à Avion un grand concours international d'accordéon qui groupait 1.000 exécutants. Au cours de ce festival, deux jeunes, tout jeunes, Saint-Polois ont reçu deux premiers prix. Nous avons voulu aller voir et entendre ces jeunes prodiges et, conduits par M. Vandecastel [Vandecasteele],
fils du chef de la jeune société l'Etoile dont les deux enfants sont membres, nous nous sommes rendu dans la coquette maison blanche où ils habitent chez leurs parents. M. Sonneville est chauffeur aux Ponts et Chaussée. Dès le seuil, la musique d’accordéon nous parvient et nous voyons le petit Pierre Sonneville qui, courageusement, à l’heure où d’autres enfants dorment ou jouent sur la plage, s’appliquait à faire sortir de façon impeccable les gammes et les accords difficiles d’une méthode presque aussi lourde que son instrument. La petite Josiane arrive bientôt, mignonne petit fille aux boucles blondes frisées, la figure souriante et pétillante d’intelligence. Elle est un peu timide, elle a laissé sa langue dans sa chambre, mais dès que nous lui demandons un morceau elle a perdu toute réserve, et son instrument se met à jouer "Simone", une valse à variation qui lui a valu son prix. Certes son jeu n’a pas toute la précision, mais ses accords et la recherche des effets font honneur à son maître M. Dehon, professeur de musique. Comme beaucoup ont pu la voir au cours de ses sorties, malgré la petitesse de l’instrument dont elle se sert, elle doit lever la tête pour pouvoir lire sa partition. Nous lui demandons son âge. Elle est née à Rosendael, le 15 novembre 1931 et ne joue de l’accordéon que depuis [?], elle est titulaire d’un 1er prix avec médaille et distinction de la 4e division A (enfants de moins de 9 ans) elle est d’ailleurs la plus jeune [??]. Mais petit Pierre, nous regarde un peu jaloux d’être oublié pourtant il ne le mérite pas car ses mérites sont au moins aussi grands que ceux de sa sœur. Il a 11 ans, étant né le 7 août 1927, à Rosendael, voici un an au mois de mai qu’il s’adonne à l’accordéon, son jeu de basses et la sureté de son exécution sont en tout point remarquables. Il travaille sur un magnifique instrument italien qui prouve combien les parents aiment la musique et ont confiance en les talents de leurs enfants. Il ne faut oublier qu’un accordéon coûte autour de 6.000 francs. C’est une somme et quand il y a deux musiciens dans la maison… Pierre Sonneville a remporté, à Avion, deux prix de 4e division B (enfants de moins de 12 ans), deux premiers prix l’un d’exécution et l’autre de lecture à vue, tous les deux remis à l’unanimité des membres du jury. Nous demandons à Madame Sonneville si elle a encore d’autres enfants. Certes non, car il aurait encore des accordéonistes dans la maison, avoue-t-elle en riant. Comme nous apercevons un poste de TSF, dans un coin de la salle à manger, nous nous étonnons qu’elle ait encore le temps d’écouter la radio avec une telle famille de musiciens. « C’est pour changer, nous écoutons de l’orchestre symphonique », pas le chant car la petite Josiane chante aussi, ou plutôt elle ne chante que les notes… nous quittons cette jeune famille d’ « artistes » en herbe, enchanté de la petite aubade et de l’excellent accueil qui nous fut réservé.
• Pierre Sonneville est né à Rosendael 7 rue Marceau, fils de Jules Désiré, serrurier puis chauffeur aux Ponts et Chaussées, originaire de Sains en Gohelle et Raymonde Fossaert née aux Moeres. En 1951 il épouse Renée Andrée Ségui née à Alger en 1930, décédée à La Turbie en 2011, Pierre est décédé en 2014 la date précise n'est pas connue de l'état civil de Rosendael.
• Sa sœur Josiane est née également à Rosendael, en 1931, elle est accordéoniste, mais on la retrouve à Malo les Bains sur un programme de 1943 où elle se produit dans un numéro de danse de claquettes et acrobaties lors d'un concert de bienfaisance pour l'entraide des prisonniers rapatriés. Elle décède à Saint Martin les Boulogne en 2018.
 |
| photo De Gryse à Rosendael |
• Raymond RICHARD, alias Richard de L'Ile, c'est un chef de musique, né à Paris en 1911, décédé en 2005, il a dirigé la batterie-fanfare de la Garde Républicaine en 1947, puis il est chef adjoint de la Musique de la Garde Républicaine de 1965 à 1969, il en est le chef de 1969 à 1972, il termine sa carrière musicale, à Bois Colombes où il dirige le Conservatoire Municipal. Mais la SACEM nous apprend qu'il a également composé sous le pseudonyme de Rey CHARRYS ! avant 1960. Ce compositeur est très présent sur l'internet, pour de nombreuses chansons populaires et musique de danse, par exemple :
C'est Bibi, java, interprétée par Rey Charrys et son orchestre musette ;
Personne, chantée par Rose Avril ;
La Java à Milo, jouée par Maurice ALEXANDER ;
Ce qu'on écrit sur le sable, chantée par Jean LUMIÈRE ;
Nid d'amour, valse musette, jouée par Adolphe DEPRINCE ;
Ma Nénette, valse musette, jouée par Ferrari, etc.
 |
| Richard De L'Ile édité par Jacky Delson |
Les Editions Jacky Delson ont publié de 1952 à 1968, environ 50 partitions, imprimées à 1000 exemplaires chacune. L'adresse indiquée : 36 rue François Tixier à Malo les Bains jusqu'en 1966 est celle des parents du compositeur, puis 29 rue Jean Jaurès à Sains en Gohelle, chez une tante.
Catalogue :
A la manouba, rumba boléro.
Amoroso, tango.
Andante et Scherzo, pour quatuor de saxophone (1956).
Amour, valse.
Au fil de l'eau, valse musette.
Amour tendre, slow rock, musique de Pierre Sonneville, créé par Arthur Briggs, Le Creusot, Edit. France Accordéon (1965).
Baby, valse.
Un baiser, une caresse, slow rock, musique de Jacky Delson, Le Creusot, Edit. France Accordéon (1965).
Balade en Toscane, paso doble (1958).
Le balochard, java.
Barque fleurie, boléro (1958).
Bigre, java.
Biloute, madison.
Blairos, cha cha.
Carnaval de Dunkerque, recueilli par P. Sonneville, enregistré par Ernest Vernet et son orchestre.
Ce n'était qu'un jeu, tango.
C’est ma grand-mère, valse musette.
Le chat de la reine, paso.
Chérinette, valse à variations.
Le chevelu, jerk, Le Creusot, Edit. France Accordéon (1966).
Chez Amar, marche, musique de Richard de L’Ile et Jacky Delson.
Ciel de feu, paso doble.
Cœur frivole. Depuis longtemps, tango.
Dis-moi, tango chanté.
Douillette, valse à variations.
El fulminante, tango.
Épineuse, valse à variations.
Esperandote, tango, une création d’Angelica, à la radio et à la télévision, Le Creusot, Edit. France Accordéon (1966).
Extrême orient, samba.
Francette, valse à variations.
Gaga-zogène, fox New Orleans.
Ile de rêve. Insouciance, valse à variations.
Je rêve de toi, boléro.
Je ris, valse.
Joli boléro (1958).
Joli nuage, boléro, musique de Pierre Sonneville.
Joyeux musicien, (le) musique P. Sonneville.
Lointain rivage, boléro (1958).
Kis Kiss, letkiss, musique de Pierre Sonneville.
Loco paso.
Ma loute, tango (1965).
Ma mie chérie, valse.
Ma parole, cha cha cha.
Ma petite femme, boléro (1958).
Mam’zelle letkiss, letkiss.
Mon pays lointain.
Musi-musette, valse, musique de Jean De Wilde et Jacky Delson (1957).
Ne dit rien, tango.
Noix de coco, cha cha cha.
Nounous, Nuevo cha cha cha, musique de Bernard Stork* et Jacky Delson.
Nuit bleue, tango.
Nuit exotique, boléro (1958),
Oasis, boléro (1958).
Octobre, valse.
Of the king, madison.
On attaque, un indicatif du tonnerre, musique de Pierre Sonneville.
Pichounette, tango (1965).
Petite Henriette, musique de Richard de L’Ile et Jacky Delson.
Pleureuse, valse à variations.
Plus jamais, tango. Pour t'aimer, boléro (1958). Pour un baiser, boléro, musique de Sonneville*. Prix orange, cha cha, paroles de Bernard Storck, musique de Bernard Stork et Jacky Delson.
Quelqu'un m'a dit, boléro (1958).
Reniflard (le), tango(1965).
Rêve oriental, boléro(1958).
Reviens chérie, rumba boléro.
Reviens moi, tango.
Rock-Folie, rock, musique de Jacky Delson, Le Creusot, Edit. France Accordéon(1965).
Rosette amour adoré, valse.
Sables d'or, valse à variations.
Sans bavure, paso doble, musique de Pierre Sonneville.
Sans espoir, boléro, musique de Pierre Sonneville.
Sans rivale, rumba boléro.
Sinovia, paso doble, musique de Richard de L’Ile et Jacky Delson.
Sois pas méchant, boléro, musique de Pierre Sonneville.
Songe d'amour, boléro (1958).
Souris à l’amour, slow rock, musique de Pierre Sonneville.
Souvenir d’un jour, tango.
Stop musette, valse, musique de Besson.
Suenos pasados, paso doble (1958).
Sur les bords de la Saône, musique de Richard de L’Ile et Jacky Delson.
Tant je vous aime, tango.
Tchaô, paso doble, musique de Pierre Sonneville.
The hippies.
Ton pays lointain, boléro, musique de Pierre Sonneville.
Totoche, java.
Tu me dégoûtes, boléro (1958).
Une femme, boléro.
Vas-y Louis.
Viejos amigos, musique de Jacky Delson et Richard de L’Ile(1958).
Yé-la !, cha cha cha musique de Pierre Sonneville.
Zouzou, java.